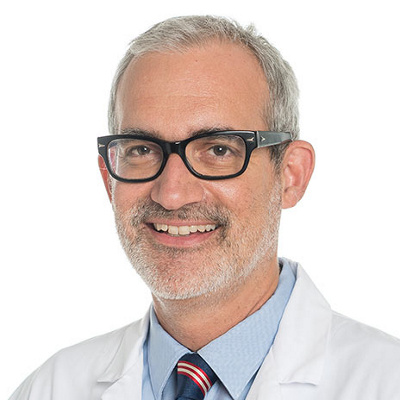Une fracture du fémur est une blessure grave de l’os de la cuisse (fémur), que l’on traite généralement par intervention chirurgicale. Selon l’emplacement et la gravité de la fracture, on la stabilise à l’aide de plaques, de vis ou de clous. Dans certains cas, notamment en cas de fractures graves ou proches de l’articulation, il peut également être nécessaire de mettre en place une prothèse de hanche.

Les fractures du fémur en bref
Les fractures du fémur peuvent toucher différentes parties de l’os du fémur : de la tête du fémur (fracture de la tête fémorale) jusqu’à la zone proche de l’articulation du genou (fracture du fémur distal), en passant par le col du fémur (fracture du col du fémur) et la diaphyse du fémur (fracture de la diaphyse fémorale).
Les fractures du col du fémur surviennent en général le plus souvent les personnes âgées atteintes de perte osseuse (ostéoporose), par exemple après une chute sur le côté. Dans de rares cas, des patientes et patients plus jeunes sont aussi touchés, le plus souvent à la suite de traumatismes à haute cinétique, comme des accidents de la circulation ou des blessures sportives graves.
Objectif de l’intervention
L’opération de la fracture du fémur vise à rétablir rapidement la stabilité, la mobilité et la capacité de marche du patient ou de la patiente. Selon le type de fracture, elle est traitée par ostéosynthèse – c’est-à-dire par fixation au moyen de plaques, de vis ou de clous –, ou par la mise en place d’une hanche artificielle.
Déroulement de l’opération
Le choix de la méthode chirurgicale dépend à la fois de la localisation exacte de la fracture et de l’état de santé général de la patiente ou du patient. L’intervention se fait soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie loco-régionale (rachianesthésie).
Pendant l’opération, l’os du fémur est dégagé dans la zone de la fracture, la fracture est soigneusement alignée et les fragments d’os sont fixés dans la bonne position. Différents procédés sont utilisés selon le type de fracture : par exemple des plaques métalliques, des clous centromédullaires, des vis de hanche dynamiques ou des clous spéciaux pour la partie supérieure (proximale) du fémur.
S’il n’y a pas suffisamment de substance osseuse stable en raison d’une fracture comminutive prononcée ou d’une perte osseuse avancée, il est possible de prélever du tissu osseux endogène, par exemple dans l’os de la hanche, et de le greffer.
En cas de fractures du fémur sévères proches de l’articulation de la hanche, telles que les fractures de la tête ou du col du fémur, l’utilisation d’une hanche artificielle (endoprothèse) peut s’avérer nécessaire, en particulier chez les patientes et patients âgés.
À la fin de l’opération, un drain est souvent mis en place afin d’évacuer les fluides de la plaie de manière contrôlée. La plaie est ensuite refermée. L’intervention dure généralement entre une et deux heures, en fonction de la procédure.
Préparation et précautions
Avant l’opération, on détermine la localisation exacte et le tracé de la fracture au moyen de radiographies. Dans les cas complexes, une tomodensitométrie peut s’avérer nécessaire pour permettre d’évaluer la fracture de manière plus détaillée.
Les examens préopératoires habituels, dont une analyse de sang, la mesure de la tension artérielle et un électrocardiogramme, sont effectués avant l’intervention. Les médicaments anticoagulants doivent être arrêtés à temps en accord avec le médecin traitant. Il est également important de rester à jeun avant l’intervention, c’est-à-dire de ne plus manger au moins six heures avant l’intervention et de ne plus boire deux heures avant.
Suivi et convalescence
La mobilisation par physiothérapie commence avant même l’intervention afin de favoriser la mobilité et prévenir les complications. Les drains insérés sont généralement retirés au bout d’un à deux jours. Les douleurs postopératoires sont traitées de manière ciblée avec des antalgiques adaptés.
Pendant l’hospitalisation qui dure environ six jours, on pratique la marche progressive avec sollicitation partielle sur des aides à la déambulation. En effet, la jambe ne doit pas être totalement sollicitée avant la guérison complète (6 à 8 semaines peuvent être nécessaires). Le processus de guérison est surveillé au moyen d’un suivi médical régulier.
Les implants, comme les vis ou les plaques, mis en place dans le cadre de l’ostéosynthèse restent généralement dans l’organisme et ne doivent être retirés que s’ils provoquent des troubles.
Complications possibles
Les opérations des fractures du fémur sont considérées dans l’ensemble comme peu risquées et se déroulent généralement sans complications graves. Cependant, comme pour toute intervention chirurgicale, certains risques ne peuvent pas être totalement exclus. Il s’agit notamment d’infections, d’hémorragies, de caillots sanguins ou, dans de rares cas, de lésions des structures nerveuses. Dans de rares cas, il arrive également que la mobilité de la hanche soit restreinte et, en particulier chez les patientes et patients âgés, il existe un risque que la capacité de marche ne soit pas complètement rétablie après l’intervention chirurgicale.
Questions relatives au traitement d’une fracture du fémur
Faut-il toujours opérer une fracture du fémur?
Une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour permettre une guérison stable et une mobilisation rapide. Un traitement conservateur ne peut être envisagé que pour les fractures très stables non déplacées ou chez les patientes et patients pour qui l’opération présente un risque élevé.
Combien de temps dure la convalescence après une fracture du fémur?
La durée de guérison après une fracture du fémur est généralement d’environ six à huit semaines. En cas de fractures plus complexes ou chez des personnes âgées, la guérison peut être proportionnellement plus longue. La rapidité à laquelle on retrouve une mobilité complète dépend fortement de l’état de santé individuel et de la réadaptation suivie.
Combien de temps reste-t-on à l’hôpital après une opération de fracture du fémur?
Le séjour stationnaire après une fracture du fémur dure généralement entre cinq et sept jours. Il est généralement suivi d’une phase de réadaptation – en ambulatoire ou en stationnaire – afin de rétablir la mobilité de manière ciblée.
Quand peut-on reprendre le volant après une fracture du fémur?
Après une fracture du fémur, il n’est permis de reprendre le volant que lorsque la sollicitation de la jambe ne provoque plus de douleur et si la capacité de réaction est suffisante – en règle générale au plus tôt 6 à 8 semaines après l’opération. Une validation médicale est recommandée.
Combien de temps reste-t-on en incapacité de travail après une fracture du fémur?
La durée de l’incapacité de travail à la suite d’une fracture du fémur dépend de la profession, du type de fracture et du processus de guérison. Pour les activités physiquement exigeantes, l’incapacité de travail peut durer plusieurs mois, tandis que l’on peut envisager un retour au bureau au bout de quelques semaines seulement.
Centres 7
-
Ortho Aarau
Schänisweg
CH-5001 Aarau -
Orthopédie et traumatologie
Avenue d'Ouchy 31 1006 Lausanne